
René Guénon et le bouddhisme
Nous avons choisi de traiter ce sujet d'abord par reconnaissance envers l'influence spirituelle de celui qui fut et reste le maître du renouveau traditionnel. La lecture de son œuvre, en 1956, nous fit passer du stade de l'occidental-intéressé-par-le-bouddhisme, à l'état de bouddhiste pratiquant, d'upasaka ou fidèle laïc, suivant les formes rituelles, à une époque où, en France, ceux-ci se comptaient sur les doigts de la main. Ensuite, parce que notre engagement dans les milieux des bouddhistes occidentaux nous a fait percevoir, tout à la fois, les vertus essentielles de l'œuvre guénonienne pour la compréhension droite du Dharma, et les obstacles apportés par les variations du jugement de René Guénon, primitivement défavorable au bouddhisme. Enfin, parce que certaines considérations tirées de l'œuvre guénonienne permettent de mieux saisir le sens et la portée de l'introduction du bouddhisme en Occident.
Rappel historique
Il nous faut d'abord examiner quelles ont été les positions successives de René Guénon devant le bouddhisme et leurs causes. Dans la première édition de l'Homme et son devenir selon le Védânta (Bossard, 1925) et dans l'Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues, de 1921 à 1939, ainsi que dans les articles rédigés durant cette période, Guénon soutenait l'hétérodoxie du bouddhisme. Lorsque, dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, il prit connaissance de la documentation apportée par A. K. Coomaraswamy, puis par Marco Pallis, il reconnut son erreur et décida de la rectifier, d'abord dans les éditions anglaises des ouvrages précités, puis dans les nouvelles éditions françaises qui parurent dans l'immédiat après-guerre.
On peut se demander pourquoi cette erreur, d'ailleurs passagère, la seule sans doute sur le fond, décelable dans son œuvre. Marco Pallis qui fut l'artisan actif de la réparation en donne l'explication suivante :
« Le nouvel enthousiasme du jeune Guénon pour la sagesse védantine telle que le grand Shankaracharya l'a exposée le conduisit à rejeter anatta, et avec celui-ci le bouddhisme entier, considéré comme rien de plus qu'une ride d'hérésie sur l'océan de l'intellectualité hindoue; le fait de ne pas avoir consulté de textes bouddhistes parallèles fut responsable de la conclusion hâtive à laquelle il tint obstinément pendant un temps» On sait en effet que Shankara fut un vigoureux défenseur de l'orthodoxie hindoue contre le bouddhisme, ce qui du point de vue hindou était fort légitime, alors même que ses adversaires l'accusaient d'être un bouddhiste déguisé, ce qui n'est pas entièrement faux car, à l'épreuve, les attitudes spirituelles du Védânta et du bouddhisme Mahayana s'avèrent très proches... pour ne pas dire superposables.
Pour lever les malentendus nous allons envisager plus en détail certains des points de vue négatifs initiaux de René Guénon concernant le bouddhisme.
Tout d'abord il a relativement peu parlé du bouddhisme, ce que confirme aisément la lecture de l'index général de son œuvre rédigé par André Désilets. Il est vrai qu'on ne saurait parler de tout et qu'en l'absence d'informateur bouddhiste qualifié, ce que confirment ses bio graphes, le jeune Guénon était bien obligé de se contenter des informations en provenance soit des universitaires, soit des théosophes et occultistes, et dans les deux cas la littérature était souvent affligeante. On trouve quelques échos des tendances rationalistes de l'époque dans cette citation d'Alexandra David, pas encore Neel, qui heureusement s'améliora beaucoup par la suite: « Le bouddha doit être considéré comme le père de la libre pensée». Les préjugés de cet ordre avaient largement influencé les commentaires des spécialistes occidentaux, tout particulièrement dans leur présentation du Theravada, ou de ce qu'ils considéraient comme le bouddhisme originel. On en trouve une critique de Guénon lui-même, en 1936, concernant l'ouvrage de Me Rhys Davids, par ailleurs estimable érudite, The Birth of Indian psychology and Its Development in Buddhism. Le dessèchement rationa- liste, le scientisme réducteur, le psychologisme, les préjugés antimonastiques, se donnaient libre cours à l'époque, ce qui a pu amener le jeune Guénon à se faire une idée fausse sur ce qui était alors présenté comme le véritable bouddhisme, « originel », dont le Mahayana représentait une dégénérescence, et le Vajrayana une corruption magique et quasi porno-graphique, prétendaient les hommes de science.
Nous pourrons relever qu'une partie des remarques incluses dans l'édition de 1930 de l'Introduction générale à l'étude des doctrines hindoues. Certaines sont pertinentes lorsque Guénon souligne l'aspect non-théiste du bouddhisme, son dépassement des dualités telles qu'optimisme ou pessimisme, l'importance de l'élément sentimental où la compassion joue un rôle analogue à celui de la charité cosmique en Islam, etc. D'autres sont très critiques: le bouddhisme est une « déviation » et une « anomalie antitraditionnel et socialement anar- chique», on retrouve la même imputation d'« anarchie dans l'ordre intellectuel et dans l'ordre social... » en un article du Voile d'Isis de 1932. On relève même une erreur d'information lorsque Guénon nous apprend que Çakyamuni eut comme précepteur Mahavira. Et si Guénon consent à lui trouver des qualités cela vient de ce que tout ce que le bouddhisme contient d'acceptable, il l'a pris au Brâhmanisme. Toutes ces appréciations péjoratives ont disparu dans l'édition de 1952. Malheureusement certaines appréciations de la même veine ont persisté dans d'autres ouvrages et peuvent encore aujourd'hui jeter le trouble dans l'esprit d'un lecteur non prévenu. On lit dans la Crise du monde moderne, écrite en 1927: Il faut dire, à l'honneur de René Guénon, qu'une fois éclairé par A. K. Coomaraswamy et M. Pallis sur les véritables caractéristiques du bouddhisme, il reconnut son erreur et porta dès lors sur cette Tradition des jugements objectifs dont nous sentons aujourd'hui tout le prix. Reconnaissant pleinement l'orthodoxie de cette voie spirituelle et le Bouddha comme «manifestation divine» (7, p. 182) il notait très justement que la raison d'être du bouddhisme était de transmettre aux non-Indiens ce que l'hindouisme fixé à sa terre et à sa société ne pouvait faire, et qu'en ce sens la situation du bouddhisme par rapport à l'hindouisme était analogue à celle du christianisme par rapport au judaïsme, « et n'est-ce pas précisément dans cette diffusion au-dehors que résiderait la véritable raison d'être du bouddhisme lui-même ?». Cet aspect universel, catholique au sens étymologique du mot, est justement ce que nous voyons se réaliser sous nos yeux.
Si Guénon n'a dans son œuvre fait « [...] qu'une brève mention de la civilisation tibétaine, en dépit de son importance [...] c'est qu'à son époque le tantrisme était [...] si mal connu en Occident qu'il serait à peu près inutile d'en parler sans entrer dans de trop longues considérations [...] ». Ce qui s'explique quand on se souvient de la qualité de la documentation mise à la disposition du lecteur moyen. Un livre largement diffusé de Robert Bleichsteiner: l'Église jaune (Payot), auquel Guénon consacre un compte rendu en 1947, ne manque pas « de déclamer contre ce qu'il appelle les "horreurs tantriques et de traiter de superstitions absurdes et lamentables" tout ce qui échappe à sa compréhension (14, p. 206). Aussi Guénon rectifie-t-il ces erreurs dans les deux comptes rendus qu'il fait de l'ouvrage de M. Pallis Peaks and Lamas, en 1947 et 1949, reconnaissant pleinement l'or- thodoxie du bouddhisme tibétain.
Quand on sait l'importance fondamentale qu'il reconnaissait à la pureté de la filiation traditionnelle, il demeurait exclu qu'un rejeton légi- time ait pu sortir d'une souche irrégulière, et Guénon lui-même de préciser, que l'irrégularité résidait dans la corruption rationaliste tardive de ce qui avait été présenté à tort en Occident comme le seul bouddhisme authentique. Quand on connaît le degré d'amoindrissement auquel était parvenu le bouddhisme à Ceylan au XIXe siècle (il y a eu depuis une renaissance méditative) on ne sera pas étonné de ce que la sclérose locale et les préjugés des informateurs anglo-saxons se soient si bien rencontrés.
Disons pour terminer que Guénon a clairement souligné l'orthodoxie du Mahayana, reconnu pour une adaptation et non une altération du bouddhisme. A ce sujet on ne saurait trop conseiller la lecture du chapitre X d'Initiation et Réalisation spirituelle intitulé: « Réalisation ascendante et descendante », où Guénon fournit une remarquablement claire explication des rôles respectifs du Pratyeka-Bouddha et du Bodhisattva, en rapport avec le problème général des Avatâras. Pour conclure ce bref survol de l'unique variation doctrinale constatée chez René Guénon, que nous attribuons, avec M. Pallis bien placé pour en juger, à l'attachement trop humain, mais passager, aux splendeurs de l'hindouisme, nous emprunterons à un autre de ses disciples, Denys Roman,cette sage appréciation: «il est bien préférable que Guénon informé par un Oriental (lui-même ramené par la lecture de Guénon aux conceptions traditionnelles) ait pu rectifier sa position sur un point aussi fondamental, que si la moitié de l'Asie s'était trompée pendant deux millénaires et même d'avantage [...]. »
René Guénon et les bouddhistes
C'est un fait que la lecture de Guénon a ramené de nombreux Occidentaux (et Orientaux) à la pratique de leur religion d'origine, et les exemples ne manquent pas de retour au catholicisme par exemple, voire d'entrée dans les ordres séculiers ou réguliers. C'est aussi un fait que des sujets coupés de leurs racines spirituelles, ou n'en ayant jamais eu, se sont tournés vers le bouddhisme, y cherchant d'abord une voie traditionnelle exotérique, puis une voie initiatique sous les formes diverses qu'elle comporte: ordination monastique qui est une initiation (ce que A. K. Coomaraswamy démontre longuement dans ses commentaires sur le terme påli: dikkhita, vœux de Bodhisattva, initiations tantriques).
Ceux-là ne se sont pas laissés arrêter par les quelques appréciations pejoratives qui subsistent çà et là dans l'oeuvre guénonienne, et l'application rigoureuse des critères traditionnels fournis par l'œuvre même, les a contraints à s'engager dans la voie du Milieu, dans les formes mêmes que celle-ci prescrit. Nous en connaissons de nombreux cas, qui deviennent de plus en plus fréquents, sans compter le nôtre propre lequel, il y a trente ans, faisait figure de précurseur. Nous ne ferons pas de statistiques, illusoires, mais tenterons de clarifier les sens de ce phénomène, maintenant social, qu'est l'implantation du bouddhisme en Occident. D'abord au niveau des individus.
Qu'est-ce qui attire ceux des Occidentaux acquis au point de vue traditionnel et convaincus du caractère orthodoxe du bouddhisme? Évoquons quelques facteurs. -L'exposition claire des méthodes de réalisation spirituelle dont les techniques de méditation, restées vivantes jusqu'à nos jours et la présence de maîtres vivants susceptibles de les enseigner. Sous cet aspect le bouddhisme apparaît comme le conservatoire des méthodes orientales et c'est là, sans doute, son legs le plus précieux à l'Occident.
-L'universalité d'un enseignement réduit à l'essentiel pour la libération et donc praticable sans difficulté spécifique dans le contexte social actuel.
- Pour certaines voies du Grand Véhicule et du tantrisme, la prise en compte affichée des nécessités de s'adapter aux conditions des derniers temps, d'obscuration spirituelle, et donc de méthodes variées, convenant aux laïques, et pas seulement aux moines.
-La large tolérance du bouddhisme, provenant de son sens aigu de la relativité des moyens, ce qui évite au débutant d'avoir à renier quoi que ce soit de son patrimoine antérieur. Étant bien entendu que, pour celui qui est convaincu de l'unité transcendante des Traditions, il n'y a pas de a conversion par exclusion d'une forme religieuse au profit d'une autre, mais choix d'un moyen de réalisation par convenance personnelle. - Cette convenance se fonde aussi bien entendu sur des motivations psychologiques, dont il convient d'apprécier le caractère relatif et tem- poraire, mais aussi très réel pour le débutant. Dans cette optique tous les cas de figure peuvent se rencontrer, en fonction des histoires individuelles évidemment variées. Notre métier de psychiatre et notre situation d'administrateur de plusieurs centres bouddhistes nous en ont fait rencontrer de tous ordres. Nous ne retiendrons pour être bref que deux points.
a) Dans l'ensemble on peut dire que psychologiquement le bouddhisme est assez loin et assez près de nous, soit dans une confortable situation moyenne. Assez loin historiquement pour qu'il apparaisse vierge des rapports conflictuels, qui éloignent l'ex-chrétien ou israélite de l'Islam par exemple. Assez loin spírituellement, pour que son caractère non théiste, repose le sujet qui a vécu des moments difficiles avec Dieu le Père et ses représentants, par exemple. Assez près psychologiquement pour que sa formulation originale en une langue indo-européenne, son style expéri- mental, causaliste, analytique, évoque des résonances sympathiques dans un esprit formé aux disciplines scientifiques. Et pour cause d'ailleurs, quand on se remémore l'importance cachée du bouddhisme dans la formation de la pensée grecque, pythagoricienne et stoïcienne. Nous renvoyons sur ce sujet, à l'ouvrage récent de S.C. Kolm. Soulignons, sans insister, l'accueil favorable fait au bouddhisme par les scientifiques, qui y trouvent des formulations métaphysiques en accord avec les conceptions nouvelles nées de la recherche. Assez près spirituellement pour que l'économie géné- rale de la voie soit aisément reconnue comme familière pour un Occidental forcément imprégné de christianisme. Ce que nous avons essayé de montrer, au colloque tenu entre religieux chrétiens et bouddhistes, à la char- treuse de Saint-Hugon, lors de la Pentecôte 1983.
b) La variété des écoles, qui sont aujourd'hui à peu près toutes repré- sentées en France, fait que toutes les familles d'esprit peuvent légitimement choisir l'une ou l'autre. Pour certains l'austérité analytique du theravada, pour d'autres le caractère abrupt, poétique et esthétique du zen, pour d'autres la luxuriance formelle du tantrisme et de ses nombreux moyens habiles (upaya). Quoi qu'il en soit la présence sur notre sol, pour la première fois de son histoire, de communautés d'importance notable, relevant de toutes les grandes Traditions, rend plus nécessaire que jamais, pour qu'elles fassent mieux que se tolérer, c'est-à-dire s'apprécient mutuel- lement et collaborent, de les envisager à la lumière de leur unité trans- cendante. Ceci nous amène à nous interroger sur les sens métaphysique et historique de ce phénomène.
L'Orient en Occident et les signes des temps.
Il n'est sans doute pas indifférent, qu'une part assez notable de ce qui a été fait pour faciliter l'implantation des communautés bouddhiques en France l'a été par des individus qui souhaitaient explicitement « l'appui de l'Orient (10, p. 130) à la reconstitution de l'« élite intellectuelle » (synonyme de spirituelle pour Guénon) qui devra concourir « au retour de l'Occident à une civilisation traditionnelle»
La période avancée de l'âge sombre dans laquelle nous vivons a vu se désagréger non seulement notre Tradition, le christianisme, mais aussi la carapace d'autosatisfaction naïve et de confiance dans le rationalisme et le scientisme qui en avaient été les ennemis déclarés.
L'initiative de quelques-uns d'aller chercher l'enseignement des quelques Tibétains survivant sur les pentes himalayennes, côté Inde, puis de les inviter à s'établir en Occident, était dans le droit fil des espoirs du guénonien de base. Le plus surprenant fut sans doute l'acceptation d'autant plus facile des Tibétains qu'ils prévoyaient la situation. Une prédiction célèbre de Padma Sambhava, introducteur du bouddhisme au Tibet (VIII siècle), informait que : « Lorsque s'envolera l'oiseau de fer et que les chevaux galoperont sur des roues, les Tibétains seront éparpillés à travers le monde comme des fourmis et le Dharma parviendra jusqu'au pays de l'homme rouge (c'est-à-dire l'Occidental, le rouge étant la cou- leur attribuée à l'ouest).
Ainsi, la destruction de la dernière civilisation traditionnelle par le matérialisme marxiste, une création occidentale, même si ce fut par canons chinois interposés, a-t-elle contribué à donner à l'Occident certains instruments de sa guérison. L'Occident barbare est allé dévaster l'Orient traditionnel (bien décrépit il est vrai), en retour celui-ci portera la lumière à l'Occident, tel a toujours été son rôle : « Ex oriente lux. Mais si nous complétons la formule, sa deuxième partie, souvent omise, ajoute: « Ex occidente dux. »
Quel magistère notre Occident pourrait-il exercer un jour, autre que celui des ordinateurs? Pouvons-nous rappeler que parmi les critères des <«< derniers jours » ou « derniers temps », précisés par les Évangiles, et qui sont tous remplis, figure: « il faut d'abord que l'Evangile soit proclamé à toutes les nations » (Marc, XIII, 10). De fait l'Évangile a été prêché aux Chinois et à l'O.N.U. mais est passablement oublié à Paris. On peut supposer que la France, première atteinte par le mal moderne, sera la première à s'en guérir, et l'accueil qu'elle fait au bouddhisme est sans doute le signe qu'un sens de l'universel est de nouveau à l'œuvre. Jean Robin écrivait tout récemment du christianisme et du bouddhisme: « Leur façon de privilégier l'esprit par rapport à la loi est également frappante, suggérant une certaine communauté de fonction dans l'économie de cette fin de cycle >> .
Localement le bouddhisme peut bien entendu satisfaire aux besoins spirituels d'un certain nombre de déracinés, et ses capacités d'adaptation sont prouvées par l'histoire. Il peut aussi contribuer à réveiller par l'exemple le sens contemplatif chez certains chrétiens et leur fournir l'aide technique de certains monastères et la fraternité spirituelle qui a régné, lors des rencontres de Saint-Hugon, citées plus haut, et lors d'autres rencontres analogues favorisées par la Commission du dialogue interreligieux monastique, branche de l'Aide inter-monastères (A.I.M.), organisme catholique, fait bien augurer de l'avenir. Cela dit, la France est chrétienne et le restera, mais autrement sans doute.
Pour l'avenir qui se dessine devant nous, les perspectives catastrophiques tracées par les politiques et technocrates en liberté ne laissent d'espoir que dans une intégration de la science et du gouvernement des choses par le spirituel. La destruction planétaire des cultures par le monde moderne est un mal apparent, en réalité l'effet de la fonction destructrice de Dieu, ou de la loi karmique de l'impermanence, suivant le langage utilisé. Elle ouvre aussi la voie à une solution planétaire des conflits. Cet âge d'or à venir ne peut être préparé, dès maintenant, que dans un esprit universel, et sans doute christianisme et bouddhisme ont-ils, sur ce point, ce sens de l'essentiel, qui devrait amener plus facilement à voir et à vivre << en esprit et en vérité (Jean, IV, 24).
Jean-Pierre Schnetzler
Article tiré du livre
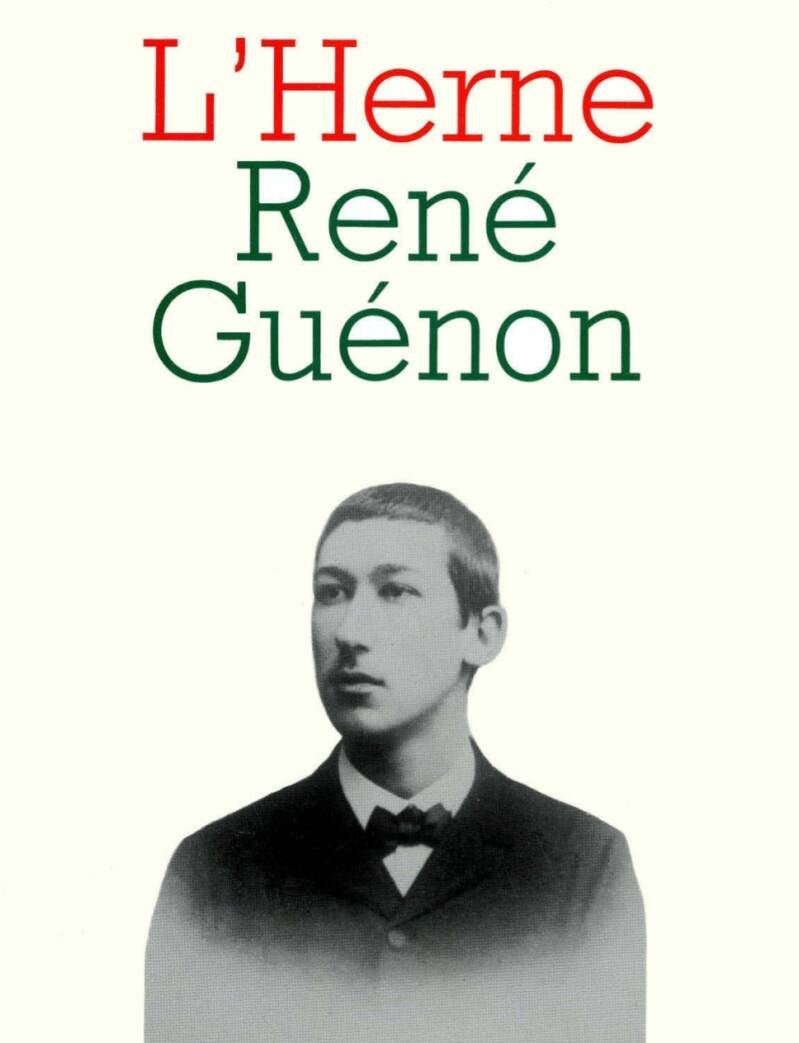
Créez votre propre site internet avec Webador