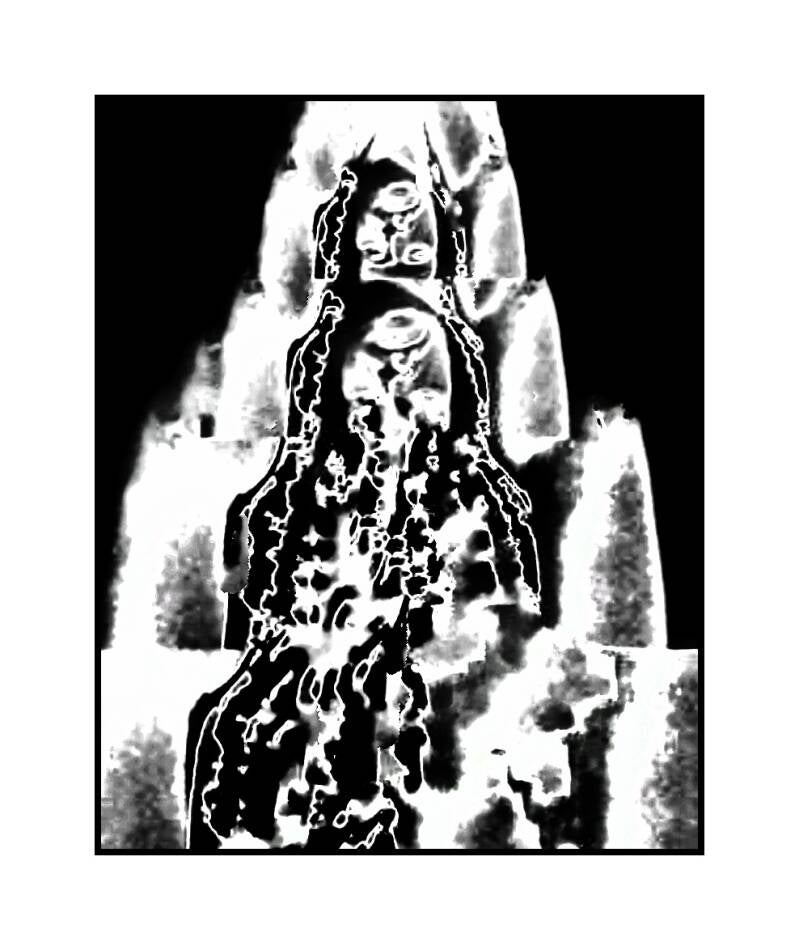
Les sources du bouddhisme ancien en tant que sources médicales
Littérature canonique
Après la mort du Bouddha, en 480 avant J.-C., un concile de cinq cents moines se réunit près de Rajagriha où le canon de l' ancienne école de sagesse est déterminé. La branche des Theravadin (« voie des anciens») rédige un canon en pali, tandis que les Sarvästivädin ( voie de ceux qui professent la réalité de toutes choses») rédigent le leur en sanskrit. Cent ans après environ se tient un second concile à Vaisali, en vue de condamner l'hérésie du Mahasanghika ( grande communauté ), précurseur de l'école Mahayana. Enfin, en 245 avant J.-C., le roi Asoka (268-226) organise un troisième concile dans sa capitale, Pataliputra. Le texte définitif du canon pali des Theravadin y est présenté.
Il est divisé en trois corbeilles (Tipitaka, skr. Tripitaka): - Le Vinayapitaka concerne la discipline monastique. Il contient :
-le Patimokkha sur la confession publique des péchés,
-le Mahavagga et le Cullavagga, qui traitent des prescriptions quotidiennes. Ces deux livres comportent de très nombreuses informations sur la médecine, surtout
le Mahavagga, en ses chapitre VI sur les médicaments, et VIII, ce dernier relatant en détail la vie du chirurgien Jivaka.
-le Suttavibhanga, qui est un commentaire des péchés.
-le Parivara, une sorte de catechisme.
-Le Suttapitaka, compilation de prédications doctrinales du Bouddha, est composé de cinq collections. Le Dighanikaya, collection des textes longs. Le Majhimanikaya, collection des textes moyens. Ce recueil contient entreu autres le Mahakammavibhanga, qui est une classification des actes. Il en existe une version sanskrite qui, en France, fut étudiée par Sylvain Levi.
-le Samyuttanikaya, collection variée.
-le Khuddakanikaya, collection mineure. Un certain nombre de textes de ce dernier livre contiennent de précieuses informations d'ordre médical. Le Dhammapada en fait partie, de même que l'Udana, recueil de courts récits edifiants, le Suttanipata, les jätaka, récits des 547 vies antérieures du Bouddha, et le Niddesa, commentaire du Suttanipata. L'intérêt du Khuddakanikaya pour l'étude de la médecine ne doit néanmoins pas faire oublier que les quatre premières collections du Sattapitaka comportent, elles aussi, quelques informations médicales.
-L'Abhidhammapitaka mélange les textes de discipline et de doctrine qui ne sont pas intégrés aux deux premières corbeilles. Il consiste en une compilation de sept ouvrages métaphysiques, pauvres en allusions à la médecine sauf le deuxième, le Vibhanga, qui montre une conception des fonctions vitales similaire à celle des textes médicaux sanskrits. La version du Tripitaka des Sarvästivädin en sanskrit est quant à elle perdue. Mais le Tripitaka n'est pas le seul canon bouddhiste. En effet, sous l'égide du roi Kaniska (78-110) s'est déroulé un quatrième concile. Ce concile marque l'avènement de la nouvelle école de sagesse, autoproclamée Grand Véhicule (Mahāyāna), tandis que l'ancienne école est qualifiée pejorativement de Petit Vehicule (Hinayana). Les mahayanistes considèrent le Tripitaka comme incomplet. Il y manque les révélations que le Bouddha aurait faites à un petit nombre d'initiés. En outre, ils proclament une éthique nouvelle, dans laquelle ils ne cherchent plus à échapper an cycle des renaissances, ce qui est égoiste, mais à aider les autres à y parvenir. La figure ideale du Mahayana n'est donc plus l'Arhar (celui qui atteint l'éveil), trop préoccupé par son nirvana personnel, mais le Boddhisattva, Bouddha en puissance, qui renonce au nirvana pour aider les hommes, par compassion pour le monde. Le Mahayana se veut ainsi plus proche du discours originel du Bouddha, discours de compassion et non d'égoïsme. Mais le Bodhisattva finit par devenir un intercesseur vers le nirvana. Autrement dit, il peut aider au salut, alors qu'en principe, celui-ci est personnel, lié uniquement aux actes et au bon karman. Les textes les plus importants du Mahayana, en sanskrit, sont le Lalitavistara, vie légendaire du Bouddha, et le Saddharmapundarika ou Lotus de la bonne loi. Tous deux font fréquemment référence à la médecine.
Littérature extracanonique
Il existe toute une littérature bouddhique extracanonique, riche en données médicales. Elle contient des textes d'origines et de natures très diverses. Le Milindapantha ( Questions de Milinda ), en pali, d'époque Sunga (187-75 av. J.-C.) relate une discussion sur la doctrine du Bouddha entre le sage bouddhiste Nagasena et le roi Milinda (Menandre l" de Bactriane), à la manière de Platon dans les dialogues de Socrate. Il s'agit d'un véritable abrégé du bouddhisme, même si le texte s'éloigne parfois du canon. Milinda demande au sage de lui expliquer la doctrine et éventuellement les contradictions du bouddhisme. Le sage lui répond souvent par des comparaisons. Certaines d'entre elles sont d'ordre médical et ont d'autant plus de valeur que Milinda passe pour avoir étudié la médecine, parmi les dix-huit disciplines nécessaires à sa formation de roi (Mil. 1, 9).
On peut également citer comme littérature bouddhique extracanonique le Divyavadana, texte sanskrit d'époque indéterminée (peu av. ou ap. J.-C.), la Buddhacarita en sanskrit d'Asvaghosa, qui fut l'un des présidents du concile bouddhique de Kaniska (78-110 ap. J.-C.), de même que le Visuddhimagga (« chemin de pureté >>) de Buddhaghosa, en pali, qui remonte à la deuxième moitié du iv siècle de notre ère. Le Visuddhimagga développe des connaissances très poussées en anatomie. Quant au Mahāvamsa, la grande chronique de Ceylan, il constitue une source intéressante sur la médecine dans la mesure où il couvre une assez large période.
Enfin, les récits de voyage des pèlerins bouddhistes chinois en Inde sont à considérer également comme sources bouddhiques non canoniques, très utiles pour l'étude des relations entre le bouddhisme et la médecine. Le pèlerin Fa Xian (337-422), qui voyagea en Inde de 399 à 414, rédigea un compte-rendu de son voyage, le Fo Kouo Ki (« Rapport sur le pays du Bouddha »). Mais il s'est peu intéressé à la médecine. Le pèlerin Xuan Zang (596-664) voyagea en Inde de 629 à 645. En 648, il rédigea lui aussi le récit de son voyage, le Da Tang Xiyuji (« Mémoire sur les contrées occidentales à l'époque des Tang »). Enfin, Yi Jing (635-713), en Inde de 671 à 695, rédigea deux mémoires. Le premier, le « Mémoire [...] sur les religieux éminents qui allerent chercher la Loi dans les pays d'Occident », n'est en fait qu'une compilation de biographies de soixante autres pèlerins de son époque, sans grand rapport avec la médecine. Mais le second, le « Mémoire sur la loi intérieure envoyé des mers du Sud »>, écrit lors de son retour en Chine par bateau, contient un nombre non négligeable d'informations ou de références d'ordre médical. Le chapitre 4 développe des considérations sur l'hygiène et la diététique, le chapitre 8, sur les aliments purs et impurs, le chapitre 18, sur les soins de la bouche, et le chapitre 23, sur les fonctions naturelles. Quant aux chapitres 27, 28, et 29, entièrement consacrés à la médecine, ils s'intitulent respectivement: << Les symptômes corporels de la maladie », « Les règles du traitement médical >> et << Interdiction des traitements médicaux douloureux >>
Sources secondaires
Les sources archéologiques ne sont pas à négliger, même si la portée des données qu'elles peuvent fournir demeure très limitée, comparée aux textes. On peut citer les sources épigraphiques que constituent les édits d'Asoka (268-226 av. J.-C.), sur rocher ou sur colonne. Ils offrent des informations datées précisément en fonction des années de règne du roi, dont certaines concernent des fondations d'hôpitaux. Les fouilles de sites bouddhistes révèlent quant à elles les vestiges de quelques établissements médicaux, mais aussi quelques ustensiles.
Extrait du livre:
Le bouddhisme et la médecine traditionnelle de l'Inde
Créez votre propre site internet avec Webador