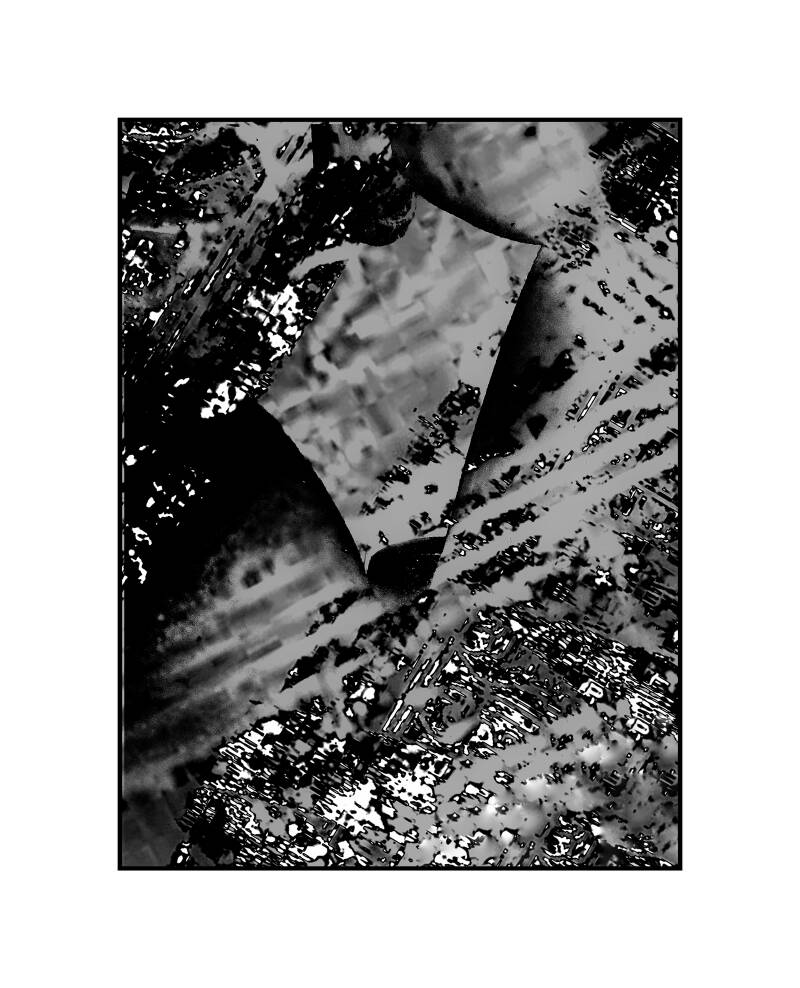
Le matérialisme réducteur explique tout sauf deux nuages
Dean Radin, PhD
Introduction:
En avril 1900, le physicien britannique Sir William Thompson, égale ment connu sous le nom de Lord Kelvin», a donné une conférence à la Royal Society. Lord Kelvin y déclara avec conviction que la physique était une science pour ainsi dire aboutie; restait selon lui deux petits nuages. à résoudre pour que l'ensemble soit parfaitement cohérent (Kelvin, 1902). Ces deux nuages seront connus sous le nom d'éther lumineux et de catastrophe ultraviolette». Tous deux faisaient référence à des anomalies qui ne cadraient pas avec la vision prédominante de ce que nous appe- lons aujourd'hui la physique classique, mais tous deux étaient également considérés comme des problèmes qui seraient finalement résolus grâce à des ajustements mineurs des théories existantes.
Huit mois plus tard, le physicien allemand Max Planck présenta une idée révolutionnaire lors d'une séance de la Société allemande de phy sique à Berlin (Planck, 1901). L'idée de Planck résolvait l'un des nuages mentionnés par Lord Kelvin et a posé les bases de la théorie quantique. Einstein expliqua l'autre nuage quelques années plus tard.
Cette tournure inattendue des événements devrait nous rappeler pourquoi les petits nuages à l'horizon méritent une attention toute par ticulière. Parfois, ils se résorbent facilement par de simples modifications des idées existantes, mais parfois ce sont des énigmes qui persistent pendant des décennies, voire des siècles. Dans de tels cas, les solutions peuvent stimuler des changements de paradigme totalement inattendus et engendrer de nouveaux concepts, de nouvelles technologies, ou même de nouvelles formes de civilisation. Par exemple, au cours du xx siècle, les deux nuages de Lord Kelvin ont fait passer le monde occidental de l'ère industrielle à l'ère atomique et celle de l'information.
Nous sommes aujourd'hui confrontés à deux autres nuages, commu- nément appelés qualia et quanta. Le premier est resté un mystère tout au long de l'histoire. Le second est apparu à la suite de l'idée révolutionnaire de Planck. Le terme qualia» fait référence à la nature de l'expérience subjective et le terme quanta» au fait que les phénomènes quantiques sont extrêmement sensibles à la présence de l'observateur. Les deux nuages soulèvent des questions sur la nature et le rôle de la conscience dans le monde physique, et tous deux sont des défis au paradigme scientifique du matérialisme réducteur - le postulat selon lequel tout est constitué de matière et d'énergie, y compris l'esprit, et que tout système, quelle que soit sa complexité, peut être parfaitement appréhendé en le réduisant à ses composantes physiques élémentaires.
Certains neuroscientifiques insistent sur le fait que les qualia ne sont pas un problème, car la conscience est un effet secondaire illusoire du fonctionnement cérébral (Church land, 1986; Crick, 1994). D'autres suggèrent que tout organisme physique dont la complexité est com parable à celle du cerveau développera spontanément une conscience par le biais d'un processus encore inconnu (Tegmark, 2015). Certains physiciens pensent que le paradoxe de l'observateur (également appelé «le problème de la mesure quantique ») est un non-problème, estimant que la conscience ne joue aucun rôle en physique, ou que le problème est déjà résolu par des concepts comme la théorie de la décohérence (Schlosshauer, 2007).
À l'instar de Lord Kelvin, aujourd'hui, de nombreux scientifiques présument probablement que ces deux nuages de conscience finiront par être appréhendés en termes conventionnels. A mon avis, ce point de vue est erroné. Ces nuages existent depuis très longtemps et résistent obstinément à toute explication conventionnelle. Contrairement aux brumes vaporeuses qui se dissipent à la lumière des théories existantes, les qualia et les quanta sont des nuages orageux qui annoncent des super-tempêtes paradigmatiques. De plus, ils sont les fers de lance d'une multitude de nuages connexes, tous plus complexes les uns que les autres (Schwartz, 2010).
Quiconque s'est penché sur la vie et l'œuvre de Mozart, de Léonard de Vinci, de Copernic, de Shakespeare, d'Einstein ou de Ramanujan ne peut nier que les génies existent, même s'ils sont rares. Sur les quelque 100 milliards d'êtres humains qui ont vécu sur Terre, il arrive de temps à autre quelqu'un dont le talent est si prodigieux qu'il modifie littéralement le cours de la civilisation.
Le défi posé par les génies est d'imaginer comment l'esprit, consi- déré uniquement comme un aspect du fonctionnement du cerveau, peut générer des théorèmes mathématiques susceptibles de changer la face du monde, des idées scientifiques révolutionnaires, des inventions hyper-créatives, des œuvres littéraires et musicales magistrales, etc., qui semblent surgir de nulle part, souvent sans qu'on s'y attende, et qui sont parfaitement aboutis (Schwartz, 2010; Heilman, 2016). Si de relles idées ne se manifestaient qu'une fois dans la vie d'un individu, nous pourrions peut-être les considérer comme un effet du hasard. Mais le véritable génie est une source constante de créativité qui bouleverse les paradigmes et qui ne peut être réduite à l'activité électrochimique d'un cerveau strictement limité aux informations qu'il a déjà acquises (Lingg et Frank, 1973; Pandey, 2001).
Les savants:
Les autistes savants ont peu, voire aucune compétence sociale, et sont dotés d'un faible QI. Néanmoins, ils peuvent faire preuve d'une mémoire extraordinaire, d'un immense talent musical, d'un grand sens artistique ou encore de capacités de calcul mathématiques fulgurantes (Dossey. 2012; Cowan et Frith, 2009; Welling, 1994). Le film Rain Man, primé aux Oscars en 1988, est en partie basé sur la vie du savant Kim Peek, qui, entre autres, pouvait se souvenir parfaitement et instantanément de chaque mot des quelque 12000 livres qu'il avait lus. Le psychiatre Darold Treffert a écrit: Kim Peek possède l'une des mémoires les plus extraordinaires jamais observées. Tant que nous ne pourrons pas expliquer ses facultés, nous ne pourrons pas prétendre comprendre la cognition humaine.
Treffert a décrit le cas de Leslie Lemke, «qui est aveugle, souffre d'une grave déficience cognitive et d'une infirmité motrice cérébrale. Il a pour- tant joué le Concerto pour piano nº 1 de Tchaikovski à la perfection à l'âge de 14 ans après ne l'avoir entendu qu'une fois» (Treffert, 2010, p. 288). Si l'on devait faire passer un test à des pianistes en bonne santé en leur demandant de jouer ce concerto sans l'avoir entendu auparavant, on peut affirmer sans risque de se tromper qu'aucun d'entre eux n'y parviendrait.
Treffert a également décrit l'étrange phénomène du syndrome du savant acquis», où, à la suite d'un accident, une personne ordinaire acquiert soudsinement des compétences de savant. Il y a aussi les cas extrêmement surprenants des savants soudains, où des personnes apparemment normales acquièrent spontanément des connaissances et des compétences sans qu'aucune raison apparente ne puisse l'expliquer.
Le fonctionnement du cerveau des savants autistes est un défi majeur pour les neurosciences, mais peut-être leurs compétences pourront-elles un jour être expliquées par des approches conventionnelles. Le mystère reste cependant entier quant à la manière dont des compétences similaires se manifestent chez des savants acquis ou soudains.
La survie:
D'autres éléments remettant en cause le postulat matérialiste selon lequel le cerveau est synonyme d'esprit proviennent d'études sur les expériences de mort imminente (EMI), sur les médiums et sur la reincarnation. Les interprétations conventionnelles des EMI font géné ralement valoir les effets secondaires d'un cerveau défaillant (Greyson er al., 2012). Ces explications sont contredites par la vivacité remarquable et la persistance des souvenirs associés aux EMI, contrairement aux sou- venirs vagues et aux facultés cognitives émoussées associés à un cerveau privé d'oxygène (Greyson, 2013). De plus, les EMI peuvent entrainer des changements de personnalité spectaculaires et positifs, ce qui n'est pas le cas pour les personnes souffrant d'hallucinations (Greyson, 1993). Tout porte à croire qu'une EMI est un état de conscience extrêmement inhabituel qui dépasse totalement les connaissances actuelles du fonc- tionnement du cerveau (Khanna et Greyson, 2014).
En ce qui concerne les médiums, des essais contrôlés en double et triple aveugle ont montré qu'ils peuvent obtenir des informations cor- rectes et vérifiables concernant leurs clients (Beischel et al, 2015; Kelly et Arcangel, 2011; Delorme et al., 2013). Ces expériences éliminent tous les biais connus et les fuites d'informations, y compris toute forme de contact direct ou indirect entre les médiums et les clients. Les médiums interprètent les informations qu'ils reçoivent comme provenant de la personne décédée, ce qui peut être le cas ou non, mais le fait que les informations soient correctes au-delà de toute probabilité pose un sérieux défi aux explications basées sur le cerveau.
Pour ce qui est de la réincarnation, le défi concerne les jeunes enfants qui rapportent des souvenirs de vies antérieures dont l'exactitude est véri fiée ultérieurement (Stevenson, 1983). Si ces cas étaient peu nombreux, les éléments de preuve pourraient être considérés comme des coïnci dences. Mais la littérature comporte des milliers d'études de cas menées par des chercheurs parfaitement conscients des fragilités psychologiques et des pressions sociales qui poussent les gens à embellir leurs croyances culturelles (par exemple en Inde); (Tucker, 2008). Si le soi est iden- tique au cerveau, alors comment un enfant peut-il se souvenir de manière vérifiable d'une autre personne que, d'un point de vue objectif, ni lui ni aucun autre membre de la famille n'auraient pu connaître?
Les phénomènes psychiques:
Personne ne remet en question l'existence des génies et des savants, bien qu'il n'y ait pas d'explications communément admises concernant leurs talents. Cependant, ces personnes sont si rares qu'il est facile de les ignorer. En ce qui concerne les preuves de la survie de la conscience, il existe de fortes divergences sur leur nature.
C'est pourquoi les phénomènes psychiques généralement rapportés, comme la télépathie, la clairvoyance, la précognition et la psychokinésie, sont essentiels. Ces expériences ont été vécues par des personnes ordi- naires tout au long de l'histoire, dans toutes les cultures, et ce, peu importe le niveau d'éducation. Plutôt que de devoir se baser (principa- lement) sur des témoignages, il est possible de trouver dans ce domaine un grand nombre d'études expérimentales rigoureusement contrôlées dans la littérature scientifique évaluée par les pairs (Radin, 1997, 2006, 2013, 2018).
Les études scientifiques sur les capacités psychiques ont débuté à la fin des années 1800. Dans les années 1950, les éléments de preuve accumulés avaient convaincu de nombreux universitaires qui s'intéressaient de prés à la littérature sur le sujet. Dès la deuxième décennie du xxr siècle, le poids des preuves empiriques avait convaincu tout le monde à l'exception des sceptiques les plus endurcis. Ce sujet est encore considéré aujourd'hui comme scientifiquement controversé, non pas parce que les données empiriques font défaut. En réalité, les implications de ces phénomènes sont si difficiles à intégrer dans un paradigme matérialiste réducteur que les détracteurs trouvent plus facile d'imaginer que les preuves sont forcément faussées d'une manière quelconque, ou bien ils insistent pour obtenir une explication convaincante avant même d'examiner les données.
La littérature sur le sujet étant très vaste, il serait impossible dans le cadre de ce chapitre de rendre justice à l'abondance des preuves. Mais pour illustrer celles dont on dispose, nous allons passer brièvement en revue un type d'expérience de télépathie.
Test de télépathie:
La télépathie consiste à percevoir le vécu, les intentions, les pensées ou les émotions d'une autre personne sans faire appel aux sens ordinaires, et ce, indépendamment de la distance géographique ou de la privation sensorielle.
Le protocole le plus efficace pour tester la télépathie en laboratoire est la méthode ganzfeld (qui signifie «champ uniforme en allemand). Dans cette expérience, une demi-balle de ping-pong est placée sur chaque ceil du récepteur» (la personne qui reçoit l'information télépathique), une lumière rouge est projetée sur son visage et il porte un casque audio qui émet un bruit blanc.
Cet état de stimulation sensorielle légère et spontanée induit une rêverie qui est considérée comme propice aux perceptions télépathiques. Pendant que le récepteur est dans cet état, il lui est demandé de rester ouvert à toute pensée ou ressenti tout en gardant à l'esprit l'émetteur. distant.
Pour réaliser cette expérience, on choisit au hasard une photo parmi une série de quatre photos, chacune représentant un objet ou une scène réelle avec un thème clairement identifiable, et présentant des couleurs, des formes et un contenu les plus différents possibles. On remet la photo sélectionnée à l'émetteur» télépathe-qui se trouve totalement isolé du récepteur télépathe - et on lui demande d'envoyer mentalement cette photo au récepteur. Notez que l'utilisation de mots entre guillemets ici indique que ces termes sont uniquement descriptifs; ils ne suggèrent pas de mécanismes sous-jacents.
L'émetteur transmet ensuite mentalement pendant vingt minutes le contenu de la photo cible au récepteur, qui, pendant ce temps-là, reste détendu dans l'état de ganzfeld. Une fois la période de transmission ter- minée, on sort le récepteur - toujours totalement isolé de l'émetteur - de l'état de ganzfeld et on lui montre les quatre photos, dont l'une représente la cible choisie.
Si la télépathie ne fonctionne pas, la probabilité qu'un récepteur choi sisse correctement la cible est d'une sur quatre, soit 25%. Si elle fonc- tionne, le taux de réussite sera supérieur à 25%. Le résultat purement aléatoire pour un seul test étant très élevé, ne procéder à ce test qu'une seule fois ne permettrait pas de démontrer la réalité de la télépathie. Mais que se passerait-il si le même test était réalisé de manière indé- pendante par des dizaines de laboratoires dans le monde entier pendant cinquante ans, et si pendant cette période près de 4000 tests de ce type étaient réalisés? La portée statistique de ce grand nombre d'essais four- nirait alors des preuves solides en faveur ou à l'encontre de sa réalité.
Méta-analyse:
Une méta-analyse est une méthode statistique quantitative combinant les résultats d'une série d'études indépendantes réalisées en s'appuyant sur des protocoles similaires. Elle permet de savoir si les phénomènes étudiés lors d'une expérience sont reproductibles et s'ils sont dus au hasard. La méta-analyse est aujourd'hui utilisée dans la quasi-totalité des sciences expérimentales, notamment dans des domaines comme la psychologie, le social et le médical, car les résultats dans ces domaines ont tendance à être extrêmement variables et il n'est donc pas possible de démontrer qu'une expérience donnée est reproductible.
De 1974 à 2018, des dizaines d'auteurs ont publié un total de 117 articles décrivant les résultats de leurs expériences avec le proto cole ganzfeld. Des méta-analyses de ces études ont été réalisées à sept reprises, couvrant différentes échelles de temps (Honorton, 1985; Bem et Honorton, 1994; Milton et Wise man, 1999; Storm et Ertel, 2001; Bem et al., 2001; Storm, Tressoldi et Di Risio, 2010; Storm et Tressoldi, 2020). Ces sept méta-analyses ont chacune donné des résultats signifi- catifs en faveur de la télépathie.
Cela signifie que des phénomènes télépathiques reproductibles ont été observés depuis plus d'un demi-siècle par des dizaines de chercheurs indépendants dans le monde entier. Si l'on considère tous les essais réa lisés avec le protocole ganzfeld utilisant quatre cibles, 3 885 essais ont été rapportés ayant abouti à 1188 résultats positifs, soit un taux de réussite global de 30,6%. Si cet écart de 5% par rapport au taux de probabilité de 25% peut ne pas sembler très impressionnant, d'un point de vue statis- tique, le résultat global est associé contre toute attente à une probabilité supérieure à mille milliards contre un.
Une critique de ce résultat méta-analytique est le postulat selon lequel certaines expériences ganzfeld ont échoué, ce qui a découragé les cher cheurs qui ont ensuite renoncé à présenter un rapport de leur étude. Un tel rapport sélectif biaiserait les résultats globaux en les faisant paraitre plus importants qu'ils ne le sont réellement. Cependant, les critiques qui avaient étudié en détail la littérature sur le sujet et qui connais saient personnellement un grand nombre des chercheurs ayant mené ces études, ont convenu que les rapports sélectifs ne pouvaient exclure les résultats globaux positifs. Le nombre d'expériences supposément manquantes nécessaires pour invalider les résultats connus serait énorme et invraisemblable.
D'autres critiques ont soulevé la question de savoir s'il n'y avait pas des failles dans le protocole expérimental qui permettraient au récepteur d'obtenir des informations sur la cible par un biais quelconque. Au fil des ans, alors que les critiques suggéraient des failles potentielles dans les protocoles, chaque faille a été systématiquement comblée, mais les mêmes résultats ont continué à être observés. Après cinquante ans de critiques, les sceptiques familiers avec ces études admettent qu'ils ne peuvent plus trouver d'explications plausibles à ces résultats. Plus important encore, les sceptiques qui avaient explicitement réfuté tout type de phénomène psychique, mais qui avaient néanmoins tenté l'expérience eux-mêmes, ont obtenu les mêmes résultats que ceux révélés par les méta-analyses.
Un nouveau cadre:
Si le paradigme matérialiste réducteur ne peut facilement relever les défis posés par les génies, les savants, les expériences de mort imminente ou la télépathie (ou autres exemples qui auraient pu être ajoutés à cette liste), alors quel paradigme le pourrait? En développant de nouveaux cadres explicatifs, il est important de s'assurer de ne pas rejeter ce que nous savons déjà. Autrement dit, un nouveau paradigme doit inclure ce qui fonctionne déjà avec succès, sinon il y a peu de raisons de l'adopter. En effet, les universitaires expriment souvent la crainte que l'adoption d'un nouveau paradigme ne les oblige à jeter tous les manuels sur lesquels ils se sont appuyés pendant si longtemps. Il n'est donc pas étonnant qu'il existe une forte reticence à rejeter des connaissances sur lesquelles une personne a fondé sa carrière. Nous avons donc besoin d'un cadre qui n'alimente pas cette crainte.
Dans cette optique, nous avons donc besoin d'un cadre qui ne porte que peu ou pas atteinte au matérialisme réducteur, tout en prenant en compte, voire en prédisant, les diverses anomalies associées à la conscience. Je crois qu'une telle structure existe et, étonnamment, elle ne nécessite qu'un simple ajustement du paradigme dominant. Il nous suffit de reconceptualiser la conscience comme un épiphénomène de l'activité cérébrale pour qu'elle devienne un élément fondamental de la réalité.
Pour illustrer pourquoi ce simple changement de postulat est com- patible avec le paradigme scientifique existant, imaginez les connais- sances scientifiques superposées en forme de pyramide. Selon la doctrine matérialiste, le niveau inférieur correspond à la physique, d'où émerge la chimie, puis la biologie, les neurosciences et la psychologie; puis, au sommet de cette pyramide, on trouve la conscience censée être produite par l'activité cérébrale. Le matérialisme réducteur considère que les phé nomènes qui relèvent de chaque niveau de la pyramide impregnent tous les niveaux supérieurs (ce qu'on appelle la causalité ascendante»). Par conséquent, si les électrons ont une importance primordiale en physique, ils sont également présents sous des formes plus complexes en chimie, en biologie, en neurosciences, etc. Dans ce paradigme, il est quasiment impossible de comprendre comment la conscience peut émerger de quoi que ce soit d'autre que de l'activité cérébrale.
La physique quantique, qui se situe tout en bas du niveau de la physique, tient compte des corrélations non locales et des événements qui se déroulent en dehors de l'espace-temps. Cela n'est pas sans rap peler l'énigme des phénomènes psychiques, bien que la pertinence de la physique quantique concernant le fonctionnement du cerveau soit actuellement considérée comme une idée très controversée. À mesure que la biologie quantique se développe, il est possible que l'on découvre des processus susceptibles de favoriser l'émergence d'un cerveau quan- tique, ce qui ouvrira la voie à une réflexion plausible sur les formes de conscience non locales.
Cependant, un cerveau quantique présente encore un problème: il ne prend pas en compte les qualia. C'est pourquoi un nombre grandissant de scientifiques et de chercheurs commencent à adopter des positions philosophiques telles que le panpsychisme, le monisme neutre et l'idéa lisme. Dans ces cadres de pensée, la conscience ne nait pas ou n'émerge pas des niveaux inférieurs; elle est plus fondamentale que cela. Elle est, tout simplement.
Dans cet esprit, imaginons que nous plaçons notre pyramide de connaissances actuelle sur un nouveau niveau inférieur que nous appel- lerons conscience; une «substance» primordiale qui transcende les idées conventionnelles sur l'espace-temps, l'énergie ou la matière. La physique, y compris la physique quantique, émerge de ce niveau inférieur; les explications matérialistes en physique, chimie, biologie et psychologie restent exactement les mêmes qu'auparavant, mais de la même façon que les élec trons imprègnent toutes les couches, la conscience imprègne maintenant tous les niveaux au-dessus d'elle. Depuis cette perspective, les génies, les savants, la survie de la conscience et les phénomènes psychiques commencent tous à avoir du sens car leur caractéristique commune est le moyen par lequel la conscience transcende l'espace-temps. A mesure que l'on approche du sommet, la façon dont la conscience se manifeste à chaque niveau de la pyramide diffère en fonction de son rôle dans les structures de plus en plus complexes. Cependant, sa nature essentielle - la conscience libérée des contraintes spatio-temporelles - demeure.
Une caractéristique importante de cette pyramide de caissances modifiée est qu'il n'est pas nécessaire de jeter les manuels car toutes les informations précédemment vérifiées restent en ement valables à chaque niveau. Nous disposons juste d'une nouvelle hypothèse métaphysique sous-jacente sur laquelle tout repose. Dans la plupart des cas, les connaissances existantes en physique, chimie, biologie et psychologie demeurent inchangées. En effet, le principal changement résiderait dans la prise en compte de phénomènes qui sont aujourd'hui exclus du discours académique en raison du postulat (probablement faux) selon lequel la physique, et non la conscience, est le fondement sur lequel repose la réalité.
Cette approche de la conscience comme modèle de référence est compatible avec la quasi-totalité des traditions mystiques et ésotériques (Huxley, 1972) et constitue une voie naturelle pour jeter un pont entre la science et la spiritualité. Des propositions ont déjà été faites pour faire la transition entre ce qui se situe en deçà de la physique et la physique classique; voir par exemple l'ouvrage de G. Spencer-Brown intitulé Lawr of Form (1972), et ceux sur le domaine en plein essor de la physique de l'information (Wheeler, 1990; Mezard et Montanari, 2009).
Il est trop tôt pour prédire quand un paradigme axé sur la conscience sera pleinement adopté par la science, mais il semble de plus en plu probable qu'il le sera un jour.
Dean Radin, PhD in La Nouvelle Science de la Conscience
Créez votre propre site internet avec Webador