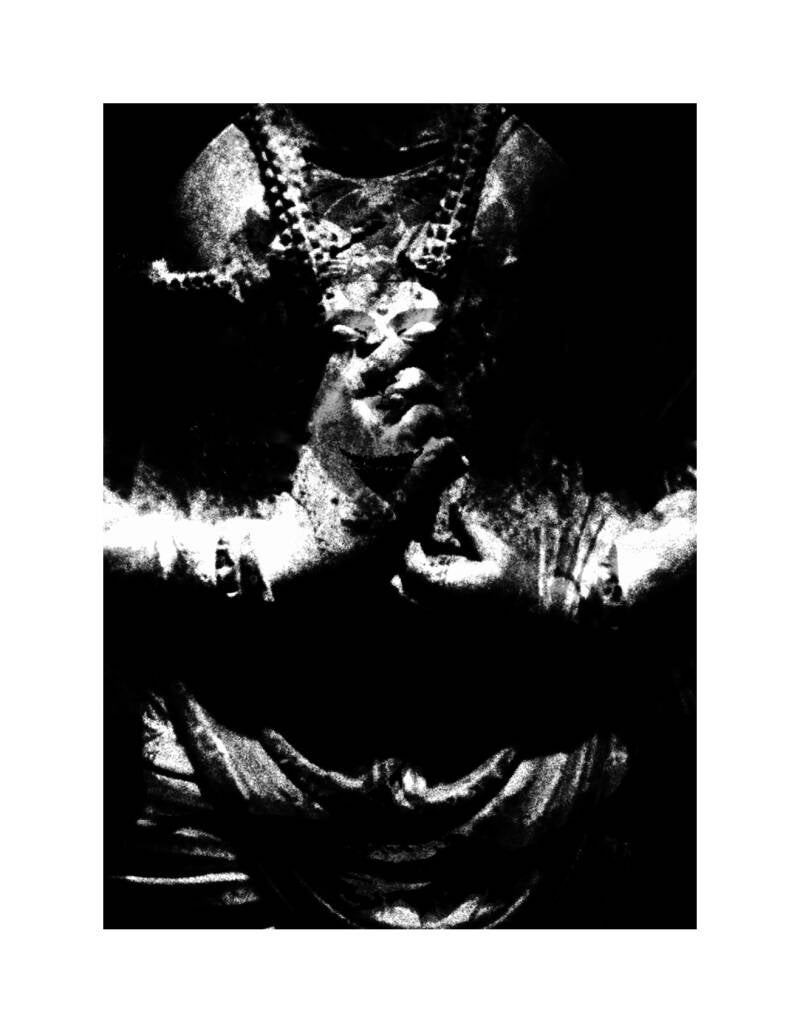
L'exemple de la douleur
"La vérité de la douleur est la douleur."
M. Henry, L'Essence de la manifestation.
Le Bouddha dit : « Ô bhikkhus, il y a deux sortes de maladie. Quelles sont ces deux sortes de maladie ? La maladie physique et la maladie psychique. Il semble qu'il y ait des gens qui ont le bonheur d'être exempts de maladie physique pendant un an ou deux [...] ou même pendant cent ans et plus. Mais, ô bhikkhus, rares sont ceux qui, en ce monde, sont exempts, un seul instant, de maladie psychique, à l'exception de ceux qui sont exempts de parasitages mentaux. >>
Sûtra-Pitaka (texte canonique du bouddhisme originaire).
Considérons une douleur physique, par exemple une douleur à la main. À sa source, elle est une sorte d'intensité instable, un flux de sensations changeant.
La douleur n'est pas une chose substantielle, c'est un événement auquel nous associons des images, des mots. Spontanément, nous en construisons une représentation. Encore vague, une pensée surgit : « Ma main me fait souffrir, j'ai mal. » Une parole intérieure peu construite se greffe alors à l'expérience. Un discours articulé autour de notions comme « moi »>, << mon >>, << je »> se surimpose (adhyâropa) à la douleur comme événement pur. Presque simultanément, une ébauche de conceptualisation se saisit de l'expérience, la commande, la déchiffre. Un jugement de valeur colore le vécu, l'interprète. À ce stade, le sujet se crispe et rejette la douleur. Selon Hénépola Gunaratana, le méditant accepte sans condition la douleur, sans s'y identifier: il observe sa manifestation et organise de manière adéquate les soins possibles. Sati consiste à dépouiller l'expérience de sa dimension imaginaire et symbolique. C'est la douleur, moins le pathos de la douleur (et son utilisation adressée à autrui).
Le méditant expérimente sans rejet, ni pensée, une intensité, un flux d'énergie. Par une attention vigilante, il suspend le réflexe de conceptualisation qui défigure et rejette le vécu. Sati est l'observation directe d'une intensité changeante, une attention à l'expérience nue. Elle est comme un acide qui ronge le traitement imaginaire des événements mentaux, elle est une présence au présent, une acceptation détachée de ce qui est. Selon les textes, l'attention rend le réel à lui- même. Elle supprime l'impression d'être séparé de l'expérience par une sorte d'écran, elle désencombre le vécu de ses désignations verbales, des projections mentales et de l'espoir. Bizarrement, même quand il s'agit de douleur, l'expérience nue est présentée comme simple et belle, exempte de manque, dépourvue d'horreur!!.
Sati concerne tous les types de phénomène. Toutefois, selon Hénépola Gunaratana, son application est plus exigeante lorsqu'elle se dirige sur les situations aimées, les objets chéris. Elle requiert alors une discipline sans faille, car l'esprit s'attache spontanément à ce qu'il aime. Intégrer cette manière de se positionner face aux événements mentaux ne va pas de soi. À l'instar de l'acquisition d'une langue étrangère, l'établissement de l'attention est un apprentissage lent et progressif. En effet, celui qui cherche à apprendre une langue étrangère commencera par mémoriser quelques mots et la grammaire de base. Au fil des semaines, il enrichira son vocabulaire pour enfin, au terme d'un long apprentissage, penser et rêver dans la langue d'emprunt. Il en va de même avec sati. Il est recommandé au débutant de pratiquer quelques minutes par jour, de préférence assis dans la position du lotus. Au final, grâce à un entraînement soutenu, l'attention est établie de manière ininterrompue, l'Éveil est alors atteint. Au début volontaire et artificiel, ce nouveau style perceptif doit être pérennisé : il s'agit de l'intégrer comme une seconde nature.
L'apprentissage de l'attention s'obtient par l'exercice de satipatthâna, un exercice de méditation qui consiste à orienter son attention successivement sur le corps, les sensations, l'esprit et enfin les objets psychiques particuliers, comme la haine ou le doute. Ainsi, il faut insister sur ce point capital : avant d'être une introspection, la thérapeutique bouddhiste repose sur un travail, une éducation, l'acquisition d'un nouveau style perceptif. La «< guérison » passe par l'exercice et l'entraînement, c'est un apprentissage.
Éric Vartzbed
Créez votre propre site internet avec Webador